

Guillaume Grand (2000) : protéger et valoriser les innovations techniques, un métier d’ingénieur
Comprendre les innovations les plus pointues, les traduire en mots précis pour les protéger juridiquement, conseiller les entreprises sur leur stratégie d’innovation : telle est la mission de l’ingénieur-brevet. Guillaume Grand (ECL00) revient sur un métier à la croisée de la technique, du droit et du business, où curiosité scientifique et rigueur juridique se conjuguent au service de la compétitivité des entreprises. Cet entretien est également l'occasion de faire le point sur les étapes essentielles pour protéger une innovation, les arbitrages entre secret industriel, communication publique et brevet, ainsi que les bouleversements à venir introduits en Europe par la Juridiction Unifiée du Brevet.
Technica : Bonjour Guillaume. Vous êtes ingénieur de formation et avez choisi la voie de la propriété industrielle. Pourquoi ce choix ?
Initialement, par hasard et par curiosité. Puis, par passion ! Avant d’arriver à l’ECL, je n’avais jamais entendu parler de propriété industrielle (PI) ni de brevets d’invention. Mon tout premier contact avec le monde des ingénieurs-brevets remonte au Forum Perspectives de 1998 (déjà co-organisé par l’ECL et les Mines de Saint-Étienne) où, en tant qu’élève-ingénieur de première année ne sachant pas trop vers quelle voie d’ingénierie me diriger, je consultais un à un les stands présents. A côté de ceux des grands employeurs industriels de l’époque se trouvait un stand modeste pour le cabinet de PI Bouju-Derambure-Bugnion (aujourd’hui disparu) : la seule personne animant le stand n’était pas un ingénieur-brevet, mais le DAF de ce cabinet qui avait remplacé au pied levé Monsieur Derambure, qui, diplômé des Mines, souhaitait recruter pour son cabinet de PI. Au travers de mes échanges avec ce DAF, j’ai pressenti que le métier d’ingénieur-brevet pourrait me convenir : comprendre des innovations techniques variées et de pointe, manier les mots pour décrire ces innovations avec rigueur, faire naître des droits de protection depuis ces mots, défendre et exploiter ces droits pour obtenir un retour sur les investissements engagés dans la recherche et le développement de ces innovations.
J’ai ainsi découvert par hasard une profession fascinante où se mêlent technique, droit et business ! De cette première étincelle d’intérêt s’en est suivi un long chemin de découverte, d’apprentissage et de professionnalisation, qui s’est étalé sur ma deuxième année à l’ECL (stage de 2ème année dans un cabinet de PI), sur ma troisième année à l’ECL (plusieurs modules de formation à la PI à l’extérieur de l’École et stage de 3ème année dans le Service PI d’un groupe industriel) et sur mes cinq premières années de carrière au sein d’un cabinet de PI (successivement Diplôme Universitaire en Droit des Brevets, Examen de Qualification Français pour représenter des clients auprès de l’INPI, et Examen de Qualification Européen pour représenter des clients devant l’Office Européen des Brevets). C’est un réel investissement en temps et en énergie en début de carrière, mais c’est un passage obligé pour « transformer » un ingénieur en un ingénieur-brevet et lui permettre d’exercer pleinement.
Depuis, ce métier d’ingénieur-brevet m’a permis et me permets toujours de rencontrer et de travailler avec des interlocuteurs variés mais toujours talentueux : des ingénieurs-brevets (collègues, clients ou adversaires), des inventeurs, des dirigeants d’entreprises de tailles variées (clients ou adversaires), des examinateurs travaillant dans les offices de brevet, des avocats, des juges, des agents de brevet étrangers, des commissaires de justice, des investisseurs, … Le métier d’ingénieur-brevet est devenu pour moi une véritable passion professionnelle, source de grandes satisfactions et d’accomplissement.
En pratique, un ingénieur-brevet exerce soit dans un cabinet de Conseils en Propriété Industrielle (cabinet de CPI), ce que j’ai fait de 2000 à 2024 au sein du Cabinet Lavoix (actuellement dirigé par un ingénieur diplômé de l’ECL, Philippe BLOT (1992)) dans lequel j’ai moi-même porté le titre de CPI à partir de 2004, soit dans un service interne d’une entreprise, ce que j’ai fait en 2024-2025 au sein du Service PI du Groupe Michelin. Depuis le 1er octobre 2025, je suis redevenu CPI dans le Cabinet Didier Martin (également dirigé par un ingénieur diplômé de l’ECL, Jean-François WEBER (1999)).
Technica : Après plus de vingt ans dans la propriété industrielle, comment votre pratique du métier d’ingénieur-brevet a-t-elle évolué ?
Sur la forme, la pratique du métier d’ingénieur-brevet a évolué et continue d’évoluer de manière similaire à celle des professions techniques et juridiques : toujours plus de numérisation et de tâches assistées par des outils informatiques et aujourd’hui d’IA.
Sur le fond, je pense que l’internationalisation de l’économie (de production et de distribution) et du droit des brevets a fait bouger les habitudes des ingénieurs-brevets, et ce sur des plans très variés : les conseils et stratégies de protection qu’ils proposent ; des opportunités professionnelles qu’ils peuvent saisir à l’étranger ; les négociations et contentieux auxquels ils participent ; les administrations et juridictions auprès desquelles ils interviennent.
Technica : Comment rester techniquement à jour lorsqu’on accompagne des clients dans des secteurs aussi variés ? Auriez-vous un exemple d’une problématique technique particulièrement dense qui vous aurait challengé ?
Selon moi, il est facile de rester techniquement à jour dès lors qu’on n’a pas peur de demander à son interlocuteur-expert de nous mettre à niveau : l’ingénieur-brevet n’a pas la prétention de tout connaître sur tout, mais il doit avoir la faculté d’assimiler les informations techniques qu’on lui communique pour se hisser à un niveau de compréhension suffisant pour assimiler et protéger une nouvelle invention. C’est d’ailleurs pourquoi je pense que les ingénieurs centraliens ont un réel avantage pour exercer ce métier car leur cursus d’ingénieur généraliste leur donne des bases de connaissances et de compréhension dans des champs technologiques très variés.
Après plus de 25 ans d’expérience, je n’identifie pas une problématique technique qui m’aurait vraiment mis en difficulté : ce n’est absolument pas de la vantardise, mais c’est simplement que chacune des nombreuses technologies auxquelles je me suis frotté m’a été exposée par des interlocuteurs-experts qui ont su répondre à toutes mes questions de béotien! En pratique, j’ai trouvé des problématiques techniques trapues, mais qu’on a su m’expliquer jusqu’à ce que je les comprenne : une extrudeuse agroalimentaire bi-vis traitant de matières hautement visqueuses ; une prothèse d’épaule inversée à implanter en minimisant les dommages aux tissus mous environnants ; un élément thermostatique commandant un circuit de refroidissement à multiples plages de température de fonctionnement ; une architecture de pneumatique décuplant la rigidité de dérive et le grip sec ; une imprimante 3D métal capable de fabriquer des pièces alvéolaires ; une unité de chauffage/climatisation capable d’optimiser sa consommation énergétique selon les conditions extérieures ; etc.
Technica : Sur quels critères décide-t-on qu’une innovation mérite un brevet plutôt que le secret industriel ?
Dès lors qu’une innovation est détectée comme intéressante, par exemple en ce qu’elle apporte une meilleure performance technique ou économique, on devrait toujours se demander comment traiter cette innovation : la garder secrète, la breveter (pour chercher à empêcher les concurrents de reproduire cette innovation) ou la rendre publique (pour empêcher les concurrents de déposer ensuite un brevet valable sur cette innovation).
Choisir le secret pour une innovation, c’est renoncer à la protéger par brevet. Et c’est aussi prendre le risque que la concurrence s’approprie tout ou partie de cette innovation en déposant un brevet ! Dans une économie ouverte et s’appuyant sur des technologies d’analyse toujours plus puissantes, choisir le secret est plutôt une exception car, au-delà d’organiser le secret (notamment par « verrouillage » de l’information et des personnels concernés), cette stratégie n’est envisageable que si l’innovation concernée est, dans la production commercialisée, indétectable ou inquantifiable par rétro-ingénierie. Ainsi, le secret reste aujourd’hui concevable pour notamment les innovations relatives aux procédés de fabrication au sens large.
En revanche, l’outil de la divulgation publique est de plus en plus utilisé : en rendant publique des éléments techniques innovants qu’on ne souhaite pas protéger par brevet (par exemple, pour des raisons de stratégie ou de coûts), on désamorce à moindres frais les velléités de la concurrence à déposer des brevets afférents.
L’ingénieur-brevet doit veiller à expliquer ces différentes approches aux décideurs et à les mettre en œuvre efficacement.
Technica : Expliquez-nous comment transforme-t-on une innovation issue de la R&D en un brevet solide et exploitable par l’entreprise ?
C’est là tout le savoir-faire des bons ingénieurs-brevets !
La solidité d’un brevet repose essentiellement sur des critères juridiques : l’invention revendiquée par le brevet doit satisfaire à des exigences légales (nouveauté, activité inventive, suffisance de description, etc.), que l’ingénieur-brevet a appris à maîtriser par ses formation et apprentissage à son entrée dans la profession. On notera que l’ingénieur-brevet ne conçoit rien, dans le sens où il ne participe pas aux travaux de mise au point de l’invention. En revanche, une partie importante de la solidité du futur brevet va se jouer dans les mots utilisés par ce dernier pour définir et caractériser techniquement l’invention.
Quant à « l’exploitation d’un brevet », qui ne doit pas être confondue avec l’exploitation industrielle de la technologie protégée par le brevet, elle concerne la capacité qu’aura l’entreprise titulaire du brevet à faire respecter ses droits de brevet vis-à-vis de copieurs de la technologie brevetée : l’ingénieur-brevet doit anticiper dès la rédaction du brevet la façon dont ces droits pourront être mis en œuvre dans le futur, par exemple en revendiquant l’objet « minimal » mettant en œuvre l’invention (par exemple, on revendiquera à titre principal le pneu plutôt que le véhicule équipé des pneus), ainsi qu’en veillant à ce que les caractéristiques de l’invention soient constatables/vérifiables/mesurables de manière claire et complète (faute de quoi le copieur contestera que son produit puisse être légalement qualifié de contrefaçon).
Technica : Votre poste vous place à l’interface entre ingénieurs, juristes et décideurs business : comment gérez-vous cette diversité de cultures et de langages ?
C’est une des facettes du métier que j’adore ! Évidement, on n’explique pas un brevet de la même façon à un ingénieur-concepteur, à un avocat ou un juge, et à un décideur business. De manière un peu caricaturale, je dirais que cela repose beaucoup sur le choix des mots/dessins et sur la longueur du discours ! Ceci étant, cette capacité de l’ingénieur-brevet à adapter son discours doit toujours reposer sur son analyse rigoureuse des aspects techniques, juridiques et économiques de la situation discutée.
Technica : Vous avez travaillé sur des inventions allant des dispositifs médicaux aux pneumatiques, en passant par l’agroalimentaire ou la dépollution. Avez-vous un exemple marquant où vos compétences techniques et juridiques se sont complétées pour résoudre un dossier complexe ?
J’en ai quelques dizaines en mémoire !
Mais si je devais choisir un cas remarquable, j’évoquerais la situation d’un inventeur-dirigeant qui, remercié par le propriétaire de son entreprise employeuse historique, a lancé sa propre société de conception et fabrication d’appareils de « bien-être » - volontairement, je reste un peu vague : en coordination avec son avocat ayant négocié sa sortie et sa clause de non-concurrence, il m’a fallu à la fois protéger ses nouvelles idées, vérifier que ses futurs produits ne seraient pas en contrefaçon des brevets de son ancien employeur, et l’accompagner dans un litige relatif à un brevet, qui avait été déposé en copropriété entre notamment lui et son ancien patron et dont une licence avait été donnée à son ancienne entreprise employeuse pour des produits toujours commercialisés, avant que cette licence ne soit étonnamment dénoncée peu après son départ. Bref, une affaire à tiroirs, où des batailles ont été gagnées et d’autres perdues, mais dont il est satisfaisant d’observer que cet inventeur connaît aujourd’hui le succès à la tête de sa société.
Technica : La dimension contentieuse (surveillance des concurrents, actions en cas de contrefaçon, négociations de licences) fait partie de votre métier : avez-vous un exemple d’un brevet qui n’aurait pas été respecté par un concurrent et les actions que cela aurait déclenché ?
Là encore, cela m’évoque plusieurs affaires dont je ne suis pas en mesure de vous parler librement. Mais je peux partager un cas tout à fait singulier d’une bataille judiciaire dans le domaine de l’électroménager : sur la base d’un même brevet, la société titulaire des droits a attaqué judiciairement une première fois un concurrent pour contrefaçon, en le faisant condamner (première instance, puis appel) à hauteur d’un million d’euros pour la commercialisation d’un appareil d’extraction de jus, avant d’attaquer une nouvelle fois ce même concurrent mais pour une version à peine modifiée de son appareil, qui n’a toutefois pas été considérée comme contrefaisant le brevet. Cette bataille, que j’ai vécue du début à la fin, a été émaillée de tentatives de conciliation et d’expertises en tous sens, sans jamais que le brevet concerné ne soit annulé par les juges.
Technica : Vous avez accompagné aussi bien des PME que des groupes internationaux. Quelles différences constatez-vous dans leur rapport à l’innovation et aux brevets ?
C’est une question intéressante. De par mes expériences, je dirais que la PME ou l’ETI utilise la PI et les brevets pour accompagner sa croissance de court ou moyen terme : on cherche à protéger le nouveau produit ou le nouveau service qu’on va proposer dans quelques mois ou lors des salons professionnels de l’année prochaine. L’objectif est d’éviter que la concurrence soit en position de proposer peu après le même produit ou service. De plus, la PME ou l’ETI va naturellement chercher à rationaliser en temps réel ses efforts de protection, notamment pour des raisons budgétaires et stratégiques.
Les grands groupes utilisent la PI pour soutenir leurs efforts de R&D avec un rapport au temps qui est plus long : ces grands groupes sont en capacité de déposer bien davantage de brevets, en cherchant à progressivement verrouiller de nouvelles veines ou « briques » technologiques d’où découleront peut-être, à plus long terme, des produits effectivement commercialisés. Les grands groupes travaillent sur des budgets plus conséquents, qui s’inscrivent dans une stratégie de moyen ou long terme, en intégrant le fait que leurs projets de R&D n’aboutiront pas tous sur des exploitations commerciales, mais pourront apporter des plus-values technologiques à d’autres projets, tout en gardant à distance la concurrence. La gestion du portefeuille conséquent de brevets qui en résulte doit alors s’avérer fine et raisonnée.
Quant aux start-up, c’est encore une autre approche, où se mêlent court-termisme budgétaire et nécessité d’attirer des investisseurs…
Technica : L’entrée en vigueur de la Juridiction Unifiée du Brevet (JUB) change profondément les règles du jeu en Europe. Quels avantages et quels risques y voyez-vous pour les grands groupes industriels, comme Michelin, et pour les entreprises de plus petite taille ?
Effectivement, l’entrée en vigueur de la JUB en juin 2023 bouleverse profondément le contentieux des brevets en Europe. En particulier, la JUB permet aujourd’hui de centraliser ses actions judiciaires relatives aux brevets européens à travers une grande partie de l’Europe communautaire. Il faut bien avoir en tête que la JUB a été co-construite par la puissance publique communautaire et par les praticiens du droit des brevets : cela en fait un outil qui est d’une efficacité procédurale redoutable pour traiter les contentieux de brevet (essentiellement, validité et contrefaçon des brevets européens), mais qui peut sembler complexe car totalement nouveau et conciliant des usages judiciaires des différents membres de l’Union Européenne.
Pour les grands groupes industriels, la JUB me semble s’imposer comme une évidence : par une seule procédure judiciaire, le grand groupe peut faire valoir ses droits en lien avec les brevets européens dans une grande de partie de l’Europe communautaire, dans un délai raisonnable (typiquement, moins de 18 mois pour chaque instance) et avec une certaine sécurité judiciaire dans le sens où les juges de la JUB appliquent un droit unifié et sont des juges spécialisés soit juristes, soit techniques (certains d’entre eux sont des ingénieurs-brevets). Comme les décideurs business n’aiment pas l’incertitude, cette juridiction a tout pour leur plaire, à part son coût d’utilisation car engager une action auprès de la JUB est payant (à hauteur de l’enjeu financier du litige) et nécessite de mobiliser de grosses ressources internes (ingénieurs-brevets internes, décideurs, experts techniques) et externes (équipe d’avocats et de CPI).
Pour les PME et ETI, engager une action auprès de la JUB représente bien entendu un challenge plus conséquent. Mais je pense qu’elles se l’approprieront progressivement, en fonction de l’enjeu des litiges qu’elles souhaiteront initier. Entretemps, elles seront sans doute tentées d’actionner les systèmes judiciaires nationaux antérieurs à la JUB, tels que le système judiciaire français, qu’elles connaissent mieux et qui coexisteront avec la JUB pendant plusieurs années. Là encore, l’ingénieur-brevet est au cœur du choix des stratégies judicaires possibles en lien avec le droit des brevets ! Passionnant !!
Questionnaire express :
- 3 adjectifs pour qualifier l’élève que vous étiez à Centrale Lyon ?
Curieux, engagé, têtu
- Un.e camarade de promo avec qui vous traîniez tout le temps ?
Stéphane Velay
- Votre matière préférée à Centrale Lyon ?
La tribologie
- Celle que vous appréciez le moins ?
Le sport
- Ce que vous vouliez faire comme « métier » pendant votre formation à l’ECL ?
Aucune idée !
- Que penserait l’élève que vous étiez s’il découvrait votre parcours pro jusqu’à aujourd’hui ?
Tu as bien trouvé ta voie.
- Un conseil que vous donneriez aux élèves actuellement à Centrale Lyon ?
Faites-vous plaisir dans la ou les matières techniques que vous aimez.
Auteur









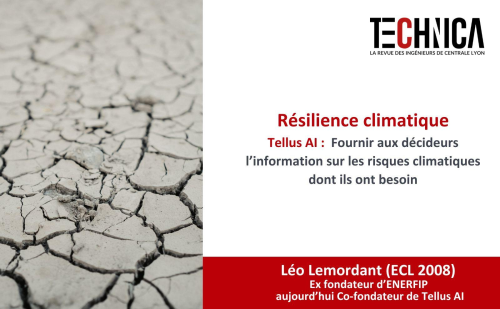



Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.